La tolérance
Que la tolérance soit une vertu souhaitable
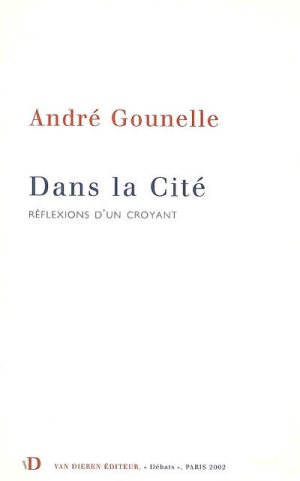 et positive, la plupart de nos contemporains le pensent, à mon sens, avec raison. Cela ne va, cependant, pas de soi, et il faut toujours s’interroger sur ce que l’on tient trop vite pour évident, sans bien mesurer les objections et les difficultés Deux écueils menacent constamment la tolérance : celui de l’excès, ou de l’outrance d’un côté, et, de l’autre, celui de l’insuffisance ou de la pénurie. Entre le "trop" et le "pas assez", où trouver le bon chemin ?
et positive, la plupart de nos contemporains le pensent, à mon sens, avec raison. Cela ne va, cependant, pas de soi, et il faut toujours s’interroger sur ce que l’on tient trop vite pour évident, sans bien mesurer les objections et les difficultés Deux écueils menacent constamment la tolérance : celui de l’excès, ou de l’outrance d’un côté, et, de l’autre, celui de l’insuffisance ou de la pénurie. Entre le "trop" et le "pas assez", où trouver le bon chemin ?
La tolérance excessive
Pendant longtemps, en gros jusqu’au dix-huitième siècle, on a jugé très négativement la tolérance. On y voyait non pas une vertu (c’est à dire, au sens étymologique, une force), mais une faiblesse. On la présentait comme un vice à combattre, et non pas comme une qualité à cultiver et à développer. En effet, disait-on, au lieu de refuser le mal, le tolérant l’admet. Il ne lutte pas contre le méchant ou le mauvais, il le laisse faire. Il s’abstient alors qu’il rendrait service en intervenant. Il se tait là où la vérité demanderait qu’on parle, et il se croise les bras là où la justice exigerait que l’on agisse. Il permet ce qui ne devrait pas être permis. Bref, il manque de moralité et de civisme ; il ne remplit pas ses devoirs envers la société et envers les autres. Quand il se comporte ainsi par complaisance ou par lâcheté, on le blâme. Lorsqu’il se trouve dans des circonstances telles qu’il ne peut agir autrement, on le plaint. On considérait que la tolérance relève d’une passivité soit coupable soit malheureuse. Elle accepte par faiblesse ou par incapacité trop de choses. En 1585, en pleine guerre civile et religieuse, le roi Henri III attribue non pas à l’intolérance, mais à la tolérance "le cours d’infinis maux et calamités que connaît le Royaume de France". Pour lui, on se divise et on se bat parce qu’on a autorisé trop de choses. Un peu plus d’un siècle plus tard, la même année, en 1691, s’expriment deux condamnations aussi vigoureuses l’une que l’autre de la tolérance religieuse. La première se trouve sous la plume du très catholique Bossuet, et la seconde vient du très protestant Synode Wallon (composé majoritairement de huguenots exilés après la Révocation de l’Édit de Nantes). Alors qu’ils s’opposent sur tout le reste, les uns et les autres s’accordent pour désapprouver la tolérance, parce que tolérer signifie admettre l’inadmissible. Quand Bossuet écrit, phrase souvent citée au moment des combats laïques du début du siècle, que le catholicisme est la plus intolérante de toutes les religions, il pense non pas en signaler un défaut, mais en souligner un grand mérite, à savoir la ferme volonté de ne pas pactiser avec le mal.
Cette critique d’une tolérance lâche et trop permissive appelle trois remarques.
Premièrement, on doit la prendre au sérieux. Elle empêche d’évacuer trop facilement la question de l’inadmissible, de l’inacceptable. Il y a des choses contre lesquelles il faut se battre. Une tolérance qui se voudrait sans limite, qui refuserait de désigner et de dénoncer l’intolérable aurait des conséquences catastrophiques. En mettant tout sur le même plan, en rendant indifférents, semblables, de même valeur les divers choix et engagements, elle démobiliserait, elle nous détournerait de nos devoirs d’être humain et de citoyen. Nous en avons un exemple avec le philosophe et théologien Paul Tillich qui lutte en 1932 contre la propagande nazie dans la Faculté de philosophie de Francfort dont il était le Doyen. Sa fonction ne l’a pas réduit et ne devait pas le réduire à une neutralité qui tolère l’intolérable.
Deuxièmement, l’essentiel ne consiste pas à plaider, de manière générale et abstraite, pour la tolérance, mais à débattre, aussi précisément que possible, sur le tolérable et sur ses limites. Que doit-on admettre et permettre, même si on le déplore et on le désapprouve, et que faut-il refuser absolument ? Autrefois, on estimait invivable la pluralité religieuse ou politique. On pensait que l’hérétique ou l’opposant représentait un danger trop grand pour qu’une société ou qu’un État l’accepte. S’il n’en va plus de même aujourd’hui, les désaccords sur les frontières subsistent. De nombreux exemples le montrent. J’en cite pêle-mêle quelques-uns. Les manipulations génétiques, l’avortement, la consommation personnelle, sans publicité, de drogues douces ou de films pédophiles, les sacrifices d’animaux ou la pratique de l’excision des fillettes, les images de violence et de sexe à la télévision, les thèses révisionnistes, font-elles partie du tolérable ou non ? On peut répondre qu’il appartient en principe à la loi d’en décider. Malheureusement, on le sait depuis l’Antigone de Sophocle, la loi n’est pas toujours sage ni juste. Pensons aux législations racistes du temps de l’antisémitisme d’État ou des régimes d’apartheid. Dans ce cas, faut-il ou non préconiser la désobéissance civile ? La juste voie entre une tolérance et une intolérance également excessives n’est ni simple ni évidente. Il me semble que même s’il ne faut pas attendre qu’il résolve tous les problèmes, on ne devrait en tout cas pas sur de telles questions économiser un débat public.
Troisièmement, il importe que la lutte contre l’intolérable corresponde bien à sa nature et qu’elle ne soit pas en porte à faux. Quand Calvin fait ou laisse exécuter à Genève Michel Servet parce qu’il rejetait le dogme de la Trinité, Sébastien Castellion, l’un des premiers apôtres de la tolérance, proteste vivement et écrit une phrase fameuse : "Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme". Répondre à un discours jugé intolérable, non pas en le discutant, en en montrant l’absurdité ou l’erreur, mais par la force ou la violence est une riposte inadaptée. Nul ne reprocherait à Calvin d’avoir tenté de réfuter les thèses de Servet. Mais le contraindre au silence par une exécution ne lui apporte pas la réplique qui convient et donne à soupçonner qu’on ne dispose pas d’arguments de fonds puisqu’on a recours à la coercition. Locke a bien mis en évidence la contradiction ou l’inconséquence profonde de la persécution religieuse : quand on veut obliger à croire par la force, on utilise des moyens non seulement inhumains, mais aussi inappropriés.
Aujourd’hui, il n’est pas sûr que des mesures de justice ou de police servent à grand chose contre des idées ou des thèmes intolérables, sinon à faire passer ceux qui les expriment pour victimes d’une intolérance instituée et organisée. Je comprends bien la nécessité d’affirmer dans certains cas : "pas de liberté pour les ennemis de la liberté" ou "pas de tolérance pour les intolérants". Pourtant, ces slogans me font peur, car pour défendre la liberté et la tolérance on les détruit et on donne paradoxalement raison à leurs adversaires par la manière dont on les combat. La perversité des fascismes consiste à pousser ceux qui le combattent à adopter eux-mêmes des comportements de type fasciste.
La tolérance insuffisante
Parfois, la tolérance se révèle excessive, en admettant et permettant ce qu’il faudrait combattre. Dans d’autres cas, elle apparaît, au contraire, nettement insuffisante. Quand on tolère ma présence dans un groupe ou dans un pays, je m’y trouve en une position d’infériorité et non d’égalité avec les autres, ce qui m’oblige à plus de prudence et de retenue que si j’y étais de plein droit. On éprouve parfois une grande gratitude de se voir ainsi toléré plutôt que rejeté ou persécuté. La tolérance n’en demeure pas moins une acceptation mesurée et restreinte. Elle ne reconnaît que partiellement la différence. Elle maintient une discrimination qu’elle adoucit sans la supprimer.
En 1787, après un siècle de poursuites et de persécutions, le roi Louis XVI a promulgué un édit de tolérance à l’égard de ses sujets non catholiques. Par rapport à la Révocation de l’Édit de Nantes, ce nouvel édit représentait un progrès certain. Il améliorait considérablement les conditions de vie des minorités religieuses et, même s’il continuait à interdire l’exercice public d’un culte autre que le catholique, il renonçait à sanctionner des opinions et des comportements privés. Pourtant, en même temps qu’il soulageait les protestants, cet édit les a beaucoup déçus. Il espéraient et demandaient, en effet, bien plus qu’une sorte de faveur ou d’indulgence. En la leur accordant, ils avaient le sentiment que le roi ne leur rendait pas vraiment justice. Quand deux années plus tard, en 1789, aux débuts de la Révolution, l’Assemblée Constituante vote la Déclaration des droits de l’homme, une discussion a lieu autour l’article 10 qui porte sur la liberté religieuse. Au cours du débat, le pasteur Rabaut Saint-Étienne, député de Nîmes, monte à la tribune et déclare : "Ce n’est pas la tolérance que je demande, mais la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, idées souverainement injustes envers les dissidents, tant il est vrai que la différence d’opinions n’est pas un crime. La tolérance ? Je demande qu’il soit proscrit à son tour, et il le sera, ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne". Ce discours invite à voir dans la différence non pas une anomalie que l’on doit, par une générosité condescendante, accepter, mais un droit à protéger et à défendre. Il permet de mesurer l’écart qui sépare la tolérance de la liberté et de l’égalité. Seule "l’insolence d’un dominateur", écrit Condorcet, nomme "tolérance" ce qui est un droit. "Celui qui tolère, écrit Goethe, insulte".
Cette critique de la tolérance jugée insuffisante appelle deux observations.
La première relève de l’éthique personnelle. Nous devons prendre conscience que, dans nos rapports avec les autres, loin d’être la vertu suprême, la tolérance représente seulement, dans le meilleur des cas, un premier pas qui doit en entraîner bien d’autres. Elle relève des préliminaires, de l’apprentissage des relations humaines. Il faut voir en elle un point de départ, plutôt qu’un but. "Elle ne devrait être, écrit Goethe, qu’une attitude provisoire ; elle doit conduire à l’accueil profond". Il ne suffit pas de tolérer les autres ; il importe de les écouter, de les comprendre, de leur rendre justice, d’entrer en dialogue avec eux. Autrement dit, la tolérance se doit de préparer le terrain pour la fraternité et de lui céder la place.
La seconde observation concerne le politique, au sens de l’organisation de la vie publique. On peut distinguer trois manières de comprendre l’unité et de construire la convivialité dans un pays. On a, d’abord, la concorde ou le consensus. Ces termes ne désignent pas la bonne entente, mais l’unanimité. Tous ont "un même cœur", "un même sens", c’est à dire des valeurs, des idéaux, des croyances, et des opinions identiques. Cet idéal de l’unanimité domine dans les sociétés totalitaires, anciennes comme modernes, qui s’efforcent d’éliminer les différences et dissidences, car elles voient dans la diversité et le désaccord une menace mortelle. Elles bannissent, déportent, internent ou exécutent ceux qui s’écartent de la ligne commune officielle. Vient, en deuxième lieu, la "tolérance", dont l’édit de Nantes, au seizième siècle donne un exemple. Faute de pouvoir établir ou maintenir par la force l’unanimité, on admet la pluralité, qu’on ne considère pas comme un bien, mais comme un moindre mal. Les majoritaires accordent aux minoritaires un statut d’exception, puisqu’ils ne peuvent pas les éliminer, et les minoritaires acceptent ce statut, puisqu’ils n’arrivent pas à s’imposer. Les uns et les autres se résignent à l’échec de leur projet et de leur ambition totalitaires. Ils se supportent mutuellement, tant bien que mal, parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Aujourd’hui, dans nos sociétés actuelles, nous sommes à la recherche d’une troisième attitude qui renonce à la concorde impossible et répressive, qui dépasse la tolérance subie et discriminatoire pour accepter pleinement la pluralité, et organiser une convivialité qui respecte l’identité de chacun, qui assure à tous la liberté et l’égalité. Cette nouvelle attitude n’est facile ni à définir ni à mettre en place, comme en témoignent les troubles que provoquent dans bien des pays la coexistence de populations diverses et la présence d’individualités marginales, comme le montrent également les incertitudes et les hésitations législatives de nos gouvernements successifs.
Au delà de la tolérance
Pour éviter aussi bien l’excès, qui admet n’importe quoi, que l’insuffisance, qui n’accepte pas vraiment l’autre, pour ne tomber ni dans le laxisme ni dans la condescendance, la tolérance doit se dépasser elle-même. Elle doit le faire au niveau personnel comme sur le plan social en servant de tremplin à ces vertus fondamentales et difficiles que proclame justement et pourtant trop facilement la République française à savoir : la liberté, l’égalité et la fraternité.
André Gounelle, Dans la cité. Réflexions d’un croyant, éditions Van Dieren, Paris, 2002.
 Gérard Delfau, Directeur de la collection
Gérard Delfau, Directeur de la collection




 Le destin de Galilée - Entre science et religion - Georges Bringuier
Le destin de Galilée - Entre science et religion - Georges Bringuier
 Un lotissement « chrétien » à L’Île-Bouchard. Didier Vanhoutte
Un lotissement « chrétien » à L’Île-Bouchard. Didier Vanhoutte
 La laïcité en Europe - Jean Claude BOUAL
La laïcité en Europe - Jean Claude BOUAL




















