Le vieil homme avance à pas hésitants ; il doit s’agenouiller et se prosterner pour entendre sa condamnation, prononcée par l’un des cardinaux du Saint-Office.
À la suite de quoi, il doit lire, mot pour mot, le texte de son abjuration que l’on a placé devant lui sur un lutrin. Sa lecture est à peine audible. Galilée a du mal à distinguer les lettres, tant sa vue, avec l’âge, a considérablement baissé.
Il se retire et regagne son siège. « Et pourtant elle tourne », murmure Galilée. Il est contraint d’avouer publiquement son erreur, alors qu’il est convaincu de son savoir. Si en apparence, l’Église sort vainqueur de ce conflit avec la science, le procès de Galilée est le point de basculement vers la séparation des deux ordres, celui du savoir et celui de la croyance.

Galilée devant le Saint-Office. Peinture de Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1847). Paris, musée du Louvre.
Présentation
Le processus de laïcisation de la science, compris comme la séparation entre science et religion, a débuté bien avant la séparation de l’École et de la religion avec les lois Ferry de 1881 et 1882 et avant la laïcisation de l’État par la loi de séparation de 1905. La laïcisation de la science, et plus largement du savoir, n’est-elle pas la condition de la laïcisation de l’École puis pour finir de l’État ?
Le point de basculement de ce processus est le procès de Galilée, en 1633, lors duquel la religion affirme, une fois encore, sa prééminence sur le savoir : « En toutes choses, y compris la science, seule, l’Église est habilitée à dire le vrai, et Aristote, sa référence universelle, plaçant la Terre au centre du monde, toute théorie contraire est hérétique. » ; telle était depuis le Moyen-Âge, la position officielle des autorités. Mais en ce XVIIe, dit le Siècle de la Raison, les savants ne vont cesser de prendre leur distance avec l’aristotélisme et aux dogmes religieux, ils opposeront une autre manière d’appréhender le monde en faisant appel à la raison. Ainsi la science va-t-elle débuter un long processus d’émancipation vis-à-vis de la religion.
Le procès de Galilée est le procès de l’héliocentrisme contre le géocentrisme. C’est le conflit entre le savoir et la croyance. Un affrontement encore en cours aujourd’hui [1], comme on le voit à propos de la contestation du darwinisme par les courants créationnistes, au sein des Églises évangéliques.
Sommaire
Prologue
Introduction
Platon et Aristote
La scolastique aristotélicienne
Le siècle de la raison
L’héliocentrisme dans l’antiquité
La révolution copernicienne
La Révolution galiléenne
Définir la science
Définir la laïcité
La science est tacitement laïque
École, laïcité et sciences
Peut-on croire à la science ?
La science contestée
Conclusion
Commander aux Editions L’Harmattan. fr
 Gérard Delfau, Directeur de la collection
Gérard Delfau, Directeur de la collection



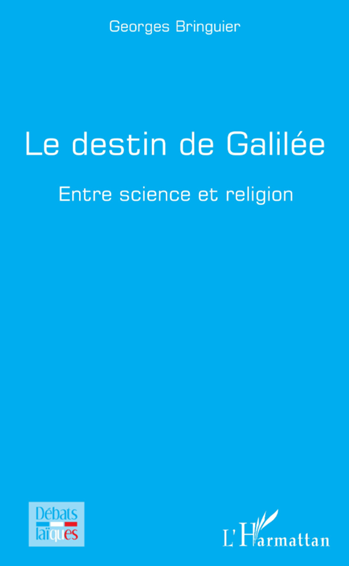

 Un lotissement « chrétien » à L’Île-Bouchard. Didier Vanhoutte
Un lotissement « chrétien » à L’Île-Bouchard. Didier Vanhoutte
 La laïcité en Europe - Jean Claude BOUAL
La laïcité en Europe - Jean Claude BOUAL
 Le choix laïque d’une intranquille - Fidaa H.
Le choix laïque d’une intranquille - Fidaa H.




















